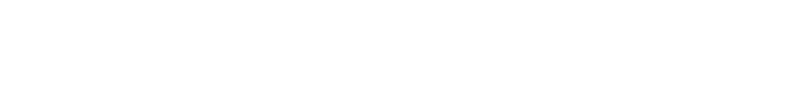S’INFORMER
Peggy et Simon sont originaires de la République Démocratique du Congo. En 2018, fuyant la répression politique, ils partent vers le Brésil pour ensuite remonter les Amériques par voie terrestre en empruntant « la route de la mort ». Ils voyagent clandestinement avec leurs deux enfants âgés de 4 et 2 ans, Peggy étant alors enceinte du troisième. Ils se dirigent vers le Canada dans l’espoir d’obtenir le statut de réfugié·e.
La famille est séparée une première fois à la frontière entre le Mexique et le Texas. Simon et les enfants sont détenu·e·s. Peggy étant enceinte, elle obtient l’autorisation d’entrer aux États-Unis et poursuit le voyage seule. Arrivant au Canada par le chemin Roxham, (point de passage frontalier irrégulier qui est désormais « fermé ») elle est placée en état d’arrestation avant de déposer une demande d’asile.
Simon et les deux enfants arrivent au Canada deux semaines plus tard. N’ayant pas de papiers d’identité, Simon est placé en détention et séparé de ses enfants. Toute la famille est finalement réunie trois semaines plus tard, quelques jours après la naissance de Benjamin. La famille s’installe à Montréal et entre dans le long processus administratif qui les mènera jusqu’à leur audience.
Trois ans plus tard, désormais travailleurs essentiels au Canada, Peggy et Simon se voient refuser leur demande d’asile en première instance ainsi qu’en appel. Considéré·e·s maintenant réfugiés refusés (c’est-à-dire sans statut, mais conservant certains droits spécifiques), cette famille se bat pour régulariser sa situation administrative et continuer à vivre dans le pays sécuritaire où ils ont refait leur vie depuis les 5 dernières années. Leur cas n’est pas isolé. Entre 2017 et 2021, 1/3 des demandes d’asile ont été rejetées.
En moyenne, 32 % des demandes sont refusées en première instance. Parmi les demandes portées en appel, 66 % sont rejetées. Après tous ces recours, la dernière chance des demandeurs d’asile est de demander la résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, dont le taux de refus est de 70%. On estime qu’environ 6 % des demandeur·se·s d’asile refusé·e·s sont renvoyé·e·s du Canada après avoir épuisé tous les recours juridiques.
Agissons dès aujourd’hui pour venir en aide aux demandeur.se.s d’asile!
Pourquoi des personnes fuient-elles la République démocratique du Congo (RDC) ?
Peggy et Simon sont persécuté·e·s politiquement en RDC. Après avoir filmé une manifestation contre le régime en place en 2017, Simon est emprisonné et torturé. Aujourd’hui encore, ils ne peuvent pas fouler le sol congolais par risque d’être gravement persécutés. En fuyant leur pays, ils acceptent le risque de ne plus jamais pouvoir y retourner.
Troisième pays d’Afrique par sa superficie, la République démocratique du Congo compte plus de 75 millions d’habitants. Depuis 1998, plus de 5 millions de personnes y ont péri en raison de la pauvreté ou de conflits violents. Ces conflits, causés par divers facteurs politiques, ethniques, économiques et militaires, ont poussé de nombreux Congolais·e·s à fuir leur foyer en quête de sécurité. Une longue et coûteuse guerre civile a pris fin en 2003, mais des vagues de violence continuent de secouer le pays régulièrement.
L’Ouganda est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugié·e·s congolais·e·s. En 2022 seulement, les attaques de groupes armés dans l’est de la RDC ont entraîné le déplacement de 98 000 réfugié·e·s vers l’Ouganda[1] , où près d’un demi-million de réfugié·e·s congolais·e·s au total sont désormais accueilli·e·s.
Le Canada a traité 1059 demandes d’asile en provenance de ce pays en 2022[2].
Quel est le contexte des pays dont sont issu·e·s les demandeur·e·s d’asile ?
Peggy et Simon font partie des 80 millions[3] de personnes qui, annuellement dans le monde, sont forcées de quitter leur foyer en raison de la persécution, de conflits, de la violence ou de violations des droits humains.
La très grande majorité des réfugié·e·s fuient leur domicile vers d’autres pays du Sud comme la Turquie, la Colombie, le Pakistan ou l’Ouganda, qui sont les pays accueillant le plus grand nombre de réfugié·e·s aujourd’hui[4]. Les pays en développement ont accueilli 85 % des réfugié·e·s dans le monde en 2021. Les pays les moins avancés, souvent frontaliers aux plus grands conflits mondiaux, en ont quant à eux accueilli 27 %. Seule une faible minorité de réfugié·e·s se retrouve au Canada et dans les pays les plus riches. Aujourd’hui, environ 1,4 % des réfugié·e·s mondiaux se trouvent au Canada, selon l’UNHCR[5].
Quelles sont les obligations du Canada face aux demandeur·e·s d’asile ?
Étant forcé·e·s de quitter précipitamment la RDC, Peggy et Simon rassemblent toutes leurs économies et mettent tout en œuvre pour pouvoir s’installer au Canada. Rêvant d’un avenir sûr dans un milieu francophone, le Québec représente pour eux un idéal de vie qu’ils souhaitent atteindre afin d’assurer un quotidien paisible pour eux et leurs enfants.
Demander l’asile est un droit protégé par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le Canada a ratifié en 1969 la Convention relative au statut des réfugié·e·s [6] de l’ONU, qui encadre les obligations des États pour protéger les personnes réfugiées. En d’autres termes, le Canada se doit d’offrir l’asile à toute personne dont la vie est menacée dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social.
Il existe des exceptions à cette règle, notamment si la personne a obtenu un statut légal dans un autre pays considéré « sûr » avant de se rendre au Canada.
Qu’est-ce que la « route de la mort » ?
Arrivé·e·s au Brésil par avion, la famille décide de prendre la route vers le Nord. Avec leurs deux enfants âgés de 2 et 4 ans, ils remontent 11 pays des Amériques clandestinement afin d’arriver jusqu’au Canada. Le passage le plus éprouvant est pour eux le détroit du Darién, entre la Colombie et le Panama. La famille traverse la frontière à pied par les montagnes, marchant pendant 10 jours dans une zone contrôlée par les narcotrafiquants. Ils y perdent leurs papiers d’identité et épuisent leurs réserves de nourriture, sauvés par des villageois locaux après plusieurs jours sans manger. Leur périple dure 3 mois entre São Paulo et Montréal.
La route de la mort, c’est la traversée clandestine de 11 pays partant du Brésil pour se rendre jusqu’au Canada. Cela représente 20 000 km de routes de campagne, de jungle, de rivières, de mers et de montagnes traversées à pied, en bus et en bateau de fortune. Passant par le Pérou, l’Équateur, la Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala, le Mexique et les États-Unis, cette traversée comportant de multiples dangers est contrôlée par les passeur·se·s qui soudoient à chaque étape des sommes considérables aux migrant·e·s dont le but est de parvenir jusqu’à la frontière canadienne pour demander l’asile.
Qu’est-ce que le chemin Roxham ?
En octobre 2018, Peggy franchit seule la dernière étape de son périple migratoire : le chemin Roxham, une route de campagne reliant l’État de New York et le Québec. Elle ne peut pas demander l’asile à un poste frontalier régulier, et doit donc comme des milliers d’autres migrants passer par ce chemin irrégulier. À son arrivée au Canada, elle est arrêtée par un agent de la Gendarmerie Royale Canadienne (GRC), et reste pendant 2 jours dans des camps d’accueil temporaires afin de passer plusieurs interrogatoires pour prouver son identité et entamer les démarches de demande d’asile.
Le chemin Roxham est une simple route de campagne qui traverse la frontière canado-américaine, sans poste douanier. Entre 2017 et 2023, il s’agissait d’un des points d’entrée irréguliers les plus importants pour se rendre au Canada et demander l’asile.
Le Canada et les États-Unis ont signé en 2002 l’Entente sur les Tiers Pays Sûrs, qui empêche de demander l’asile à un poste frontalier terrestre entre les deux pays. La logique est : un·e demandeur·se doit demander l’asile dans le premier pays sûr où on lui octroie un statut. Le Canada et les États-Unis se considèrent respectivement comme des pays « sûrs » et n’acceptent donc pas de recevoir des demandeur·se·s d’asile qui arrivent directement de l’autre pays.
La manière de contourner cette règle était donc pour les demandeur·se·s d’asile d’entrer au Canada de manière irrégulière (notamment par le chemin Roxham), ce qui leur valait d’être arrêtés par la GRC à leur arrivée, mais leur permettait au moins de demander l’asile. Il n’est plus possible d’entrer au Canada par le chemin Roxham depuis le 24 mars 2023.
En 2022, sur les 92 175 personnes qui ont demandé l’asile au Canada, environ 40 000 d’entre elles sont passées par le chemin Roxham[7]
Maintenant que le chemin Roxham est « fermé », comment les réfugiés font-ils pour présenter une demande d’asile au Canada ?
Si Peggy et Simon souhaitaient présenter une demande d’asile aujourd’hui, ils ne pourraient pas passer la frontière par voie terrestre, à moins de trouver un passage irrégulier non surveillé (et donc souvent très dangereux) pour arriver au Canada. Ils devraient par la suite rester caché·e·s 14 jours au Canada, sans accès à des soins de santé et dans la peur d’être attrapé·e·s par les autorités, avant de pouvoir présenter une demande d’asile.
Le chemin Roxham a été « fermé » le 24 mars 2023 suite à l’élargissement de l’Entente sur les Tiers Pays Sûrs[8]. Désormais, les personnes qui franchissent la frontière canado-américaine de manière irrégulière ne peuvent plus demander l’asile avant 14 jours et sont automatiquement renvoyé·e·s vers les États-Unis. Ce durcissement de la frontière rend le Canada hors d’atteinte pour bon nombre de réfugié·e·s, en les mettant à risque de situations encore plus dangereuses pour entrer au pays par voie terrestre.
Il est possible de présenter une demande d’asile au Canada en arrivant par voie aérienne, à condition d’avoir une autorisation de voyage électronique (AVE) puis de demander l’asile en arrivant en sol canadien. Il est aussi envisageable pour les personnes déjà au Canada depuis plus de 14 jours de se présenter à un point d’entrée canadien afin de demander l’asile. Ces deux méthodes représentaient déjà 60 % des cas avant la fermeture du chemin Roxham et sont maintenant les seuls moyens de faire valoir le droit d’asile auprès du Canada.
En ratifiant la Convention relative au statut des réfugiés de l’ONU en 1969[9], le Canada s’est engagé à être un lieu d’accueil pour tout demandeur d’asile. L’élargissement de l’entente sur les tiers pays sûrs est une atteinte à cet engagement, rendant le Canada inaccessible pour une grande partie des réfugiés. Il est possible d’AGIR dès aujourd’hui pour s’opposer à cette situation.
Pourquoi certaines familles sont séparées lorsqu’elles franchissent la frontière ?
Simon arrive avec ses deux enfants au chemin Roxham sans papiers d’identité. Ne pouvant prouver ni sa nationalité ni sa paternité, la GRC lui retire ses enfants. Adoration et Consolation sont placé·e·s dans deux familles d’accueil distinctes pendant 24 heures avant d’être amené·e.·s à Peggy, qui était alors hébergée à la résidence pour demandeur·se·s d’asile au YMCA Centre-Ville, à Montréal. Simon reste en détention pendant deux semaines et n’est donc pas présent pour la naissance de Benjamin, son troisième enfant. Un traumatisme supplémentaire pour la famille qui vient déjà de passer 3 mois sur la route dans l’espoir de trouver sécurité et repos au Canada.
Selon une directive nationale émise en 2017, l’Agence des services frontaliers ne doit ni emprisonner ni séparer les familles demandant l’asile, sauf dans des cas extrêmement rares. Pourtant, au moins 182 enfants ont été séparé·e·s d’un·e parent détenu·e· à des fins d’immigration au Centre de Prévention de l’Immigration à Laval en 2020, selon Action réfugiés Montréal[10]
Après être arrivé·e, comment se passe l’installation au Canada ?
Les demandeur·se·s d’asile obtiennent un statut temporaire pendant le traitement de leur dossier, ce qui leur permet de vivre et de travailler sur le territoire canadien. Peggy et Simon restent deux mois dans une résidence temporaire pour demandeurs d’asile. Ils font une demande de permis de travail et trouvent rapidement un emploi dans les secteurs essentiels de l’économie canadienne (éducation et transport). Ils emménagent dans un appartement à Verdun, aidés par différents organismes de soutien aux demandeurs d’asile.
C’est le début de leur installation au Canada, dans l’attente de l’obtention d’une date d’audience devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Ils s’intègrent rapidement à leur communauté à travers leur travail, la fréquentation de l’église et la scolarisation des enfants. Entre le moment où Peggy et Simon franchissent la frontière et leur première audience, 3 ans se seront écoulés.
Il arrive que les demandeur·se·s d’asile n’aient aucune ressource financière lorsqu’ils arrivent au Canada. La plupart ont d’ailleurs dépensé toutes leurs économies pour faire la route. Au Québec, ces dernier·ère·s sont admissibles à une aide financière de dernier recours du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec[11]. Ce chèque dont le montant mensuel avoisine les 1000 $ (variant selon nombre de personnes dans la famille) a pour but de faciliter l’installation provisoire des demandeur·se·s d’asile avant qu’ils n’obtiennent l’autorisation de travailler. L’obtention de ce chèque est souvent ce qui permet aux demandeur·se·s de quitter les résidences temporaires qui les accueillent depuis leur arrivée au Canada, afin de trouver leur propre logement.
Qu’est-ce qu’un·e demandeur·se d’asile ?
En franchissant la frontière, Peggy et Simon ainsi que leurs enfants sont devenus en 2018 des demandeurs d’asile au Canada.
Un·e demandeur·se d’asile est une personne qui a fui son pays et qui cherche la protection dans un pays sûr. Le droit de chercher et de bénéficier de l’asile est un droit protégé par la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Qu’est-ce qu’un·e réfugié·e ?
Le statut de réfugié·e est le statut de protection auquel aspiraient Peggy et Simon en venant au Canada, mais qui leur a été refusé. Pendant les trois premières années de leur séjour au Canada, ils vivent et travaillent légalement sur le territoire canadien grâce au statut de demandeur·se d’asile. Si leur demande d’asile avait été acceptée, ils auraient reçu le statut de réfugié·e, qui leur aurait donné le droit à la résidence permanente. Puisque leur demande d’asile a été refusée, ils ne sont donc pas considérés comme des réfugiés et sont actuellement sans statut.
Les réfugié·e·s au sens de la Convention[12] sont des personnes qui craignent avec raison d’être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social. L’appartenance à un groupe social peut comprendre l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le fait d’être une femme et l’état sérologique relativement au virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Pour obtenir le statut de réfugié·e, les demandeur·se·s d’asile doivent démontrer que, s’ils retournaient dans leur pays de nationalité, ils·elles seraient exposé·e·s à un risque d’être soumis·e·s à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Les instances décisionnelles qui appliquent le droit d’asile dans chaque pays varient, mais le principe du droit d’asile est le même à l’échelle internationale.
Comment peuvent se préparer les demandeurs d’asile pour leur audience ?
Après leur installation, Peggy et Simon débutent rapidement les démarches administratives nécessaires à la préparation de leur audience devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Les demandeurs sont en théorie éligibles à l’aide juridique, mais en pratique, l’offre d’avocats en immigration qui acceptent des mandats d’aide juridique est largement inférieure à la demande. Peggy et Simon se tournent donc vers un consultant en immigration, conseiller privé qui n’est pas avocat, mais peut légalement les représenter devant la CISR.
La CISR est le tribunal administratif du gouvernement fédéral chargé d’instruire les demandes d’asile. Les demandeur·se·s d’asile ont le droit de retenir les services d’un·e avocat·e ou d’un·e conseiller·ère en immigration afin de les aider à préparer leur comparution. Pour permettre l’accès à ce service, chaque province du Canada met à disposition un programme d’aide juridique soumis à sa propre législation. Pour y être admissible, il faut satisfaire deux critères principaux : démontrer son admissibilité financière à l’aide juridique et s’assurer que le domaine juridique souhaité fait bien partie des services offerts. L’immigration fait partie des catégories couvertes par le gouvernement.
Au Québec, les honoraires d’aide juridique attribués aux avocat·e·s en immigration par dossier de demande d’asile sont parmi les plus bas au Canada : entre 400 et 1000$ selon le nombre de personnes dans la famille et de formulaires à remplir. Cette compensation monétaire inclut l’étude du dossier, la rencontre avec les clients, la préparation de la comparution, la participation et la défense des clients durant l’audience, la réception de la décision de la commission et les suivis qui en découlent avec les client·es. C’est plusieurs jours, voire des semaines de travail. Il n’est pas viable pour un professionnel de vivre de ces faibles indemnités. Il n’est pas non plus obligatoire pour les avocats d’accepter des mandats d’aide juridique. En conséquence, très peu d’avocat·e·s en immigration acceptent d’accompagner des demandeur·se·s d’asile sous le couvert de l’aide juridique. Ceux.elles-ci se retrouvent donc à devoir engager eux·elles-mêmes un·e avocat·e (autour de 5000-6000$ de frais par demande) ou des consultant·e·s généralement moins cher·ère·s, mais parfois moins qualifié·e·s.
Si les montants octroyés par l’aide juridique pour les demandes d’asile étaient plus élevés au Québec, plus d’avocat·e·s accepteraient ces mandats. Les demandeur·se·s d’asile auraient donc un accompagnement beaucoup plus solide devant la justice. Mobilisons-nous dès aujourd’hui pour que les avocat·e·s en immigration puissent représenter leurs client·e·s dignement.
En quoi consiste l’audience des demandeur·se·s d’asile ?
La première comparution de Peggy et Simon devant la CISR a lieu le 8 septembre 2021, soit presque 3 ans après leur arrivée au Canada. Après une journée complète d’audience, qui est largement ralentie par des documents manquants au dossier, le commissaire décide de prévoir une deuxième journée d’audience afin de poursuivre le processus de vérification de l’identité de la famille. Deux mois plus tard, le 23 novembre 2021, a lieu la deuxième séance à la CISR, qui porte essentiellement sur le statut administratif actuel de la famille au Brésil. Le 23 février 2022, Peggy et Simon comparaissent pour la troisième fois pour raconter les persécutions qu’ils ont vécues en République Démocratique du Congo. Aucun verdict n’est donné sur place. Ils reçoivent par la poste le 8 juin 2022 un avis de refus de leur demande, justifié par l’exclusion 1E : puisqu’ils ont un statut de résidence permanente au Brésil, pays considéré « sûr » pour la famille, ils ne sont donc pas éligibles au statut de réfugié au Canada.[13]
Après avoir rempli le formulaire Fondement de la demande d’asile[14] pour détailler leur parcours et les motifs de persécution qu’ils ont subis, les demandeur·se·s doivent rassembler tous les documents attestant de leur identité et prouvant leurs allégations. Ils sont ensuite convoqués pour une audience devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, où un commissaire (juge administratif), les interroge sur leur dossier et leur histoire. Les audiences durent habituellement une demi-journée et se tiennent à huis clos, ceci afin de protéger les demandeur·se·s.[15]
En moyenne, 32 % des demandes sont refusées en première instance. En cas de refus, les demandeurs d’asile ont le droit de faire appel à la décision de la CISR auprès de la Section d’appel des réfugiés (SAR).
En quoi consiste faire appel ?
Étant dans leur droit de contester la décision de la CISR, Peggy et Simon constituent leur dossier d’appel dans l’espoir de voir leur demande approuvée. Accompagnés par une avocate en immigration, ils réunissent tous les documents nécessaires afin que leur cas soit à nouveau étudié.
Dans les quinze jours qui suivent la date de réception de la décision émise par le commissaire, les demandeur·se·s d’asile refusé·e·s doivent transmettre leur avis d’appel afin d’obtenir le réexamen de leur dossier. En général, la décision de la Section d’appel des réfugiés est rendue sans la tenue d’une audience, sauf si le dossier comporte des nouvelles pièces justificatives significativement importantes pour la prise en compte du dossier.
En moyenne, 66 % des demandes en appel sont rejetées. En cas de refus, les demandeur·se·s refusé·e·s peuvent soit porter la cause en cour fédérale, soit déposer une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaires, s’ils·elles y sont éligibles.
Quel est le statut de Peggy et Simon en ce moment ?
À l’heure actuelle, Peggy, Simon et leurs deux enfants les plus âgés (Adoration et Consolation) sont réfugié·e·s refusé·e·s (c’est-à-dire sans statut, mais avec certains droits spécifiques conservés). Leur plus jeune fils, Benjamin, né au Canada, est quant à lui citoyen canadien.
Un·e réfugié·e refusé·e au Canada est une personne dont la demande d’asile a été refusée par la Section de la protection des réfugiés suite à sa comparution devant la CISR (Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada) au cours de son audience ou suite à sa demande d’appel.
Jusqu’à leur renvoi, les réfugié·e·s refusé·e·s ont le droit de continuer à travailler tant que leur permis de travail temporaire est valide. Ils·elles sont aussi en droit de le renouveler, moyennant des frais. Ils·elles ont également le devoir de scolariser leurs enfants et peuvent toujours prétendre à une couverture médicale grâce au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) et la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Pourquoi la citoyenneté de Benjamin ne donne pas accès à la citoyenneté à toute la famille ?
Benjamin devra attendre ses 18 ans pour pouvoir parrainer l’ensemble des membres de sa famille et que ces derniers puissent ainsi demander le statut de résidence permanente au Canada. Actuellement âgé de 4 ans, cette option est encore très lointaine pour les parents et les frères et sœurs du petit.
Dans certains pays, avoir un·e enfant né·e en territoire différent de la nationalité des parents octroie un statut permanent à l’ensemble de la famille. C’est le cas au Brésil, par exemple, où les parents étrangers d’un·e enfant né·e sur le sol brésilien obtiennent automatiquement le droit à la résidence permanente.
Au Canada, on obtient généralement la citoyenneté par le « droit du sol » c’est-à-dire à la naissance sur le sol canadien. L’autre avenue pour obtenir la citoyenneté est la filiation (être né·e d’un·e parent canadien), plus communément appelée le «droit du sang». Le « droit du sol » s’applique seulement à l’enfant né·e au Canada, mais pas à ses parents et aux membres de sa famille.
L’autre avenue pour obtenir la citoyenneté canadienne est de passer d’abord par la résidence permanente. C’est le statut qui est notamment octroyé aux réfugié·e·s accepté·e·s par le Canada. Une personne peut devenir citoyenne canadienne si elle a habité au Canada comme résidente permanente au moins 6 mois par année, pendant 4 ans, dans les 6 dernières années de sa vie.
Quelle est la différence entre la résidence permanente et la citoyenneté canadienne ?
La résidence permanente est le seul statut permanent qui existe au Canada en dehors de la citoyenneté. Elle octroie la majorité des droits de toute personne citoyenne au Canada à l’exception du droit de vote et du droit au passeport. Malgré tout, ce statut est assujetti à des règles de présence sur le territoire canadien. Un·e résident·e permanent·e ne peut pas passer plus de 2 ans sur une période de 5 ans à l’extérieur du Canada si il·elle veut conserver son statut. Un crime dit « grave » constitue également une raison pouvant destituer une personne de son statut de résident·e permanent·e.
Qu'est-ce que la demande de résidence permanente pour motifs d'ordre humanitaire ?
Peggy et Simon ont déposé une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire, une solution de dernier recours, pour laquelle le soutien de leur communauté est crucial. Plusieurs voisin·e·s, ami·e·s, parents, collègues ont écrit des lettres pour appuyer leur dossier. C’est une demande qui permet de tenir compte de l’ensemble de l’histoire de la famille, de leur degré d’intégration au Canada et du bien-être des enfants. Ils devaient épuiser toutes les autres démarches préalables avant d’être éligibles à soumettre cette demande. Le délai de traitement de la demande est actuellement estimé à 25 mois, pendant lesquels la famille n’est pas protégée d’un possible renvoi.
Une demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire est un recours juridique exceptionnel. Il ne s’agit pas d’un programme régulier permettant d’obtenir un statut de résident permanent au Canada. C’est le gouvernement fédéral qui décide s’il accepte ou non la demande. Pour prendre cette décision, il tient compte des facteurs suivants :
● le sérieux des conséquences si cette demande est refusée ;
● le niveau d’intégration au Canada au moment de la demande (c’est-à-dire le fait de vivre et de travailler au Canada) ;
● la présence de membres de sa famille au Canada (par exemple, le fait d’avoir des enfants né·e·s au Canada) ;
● le bien-être des demandeur·se·s au Canada ;
● la santé, la sécurité et le bien-être des enfants des demandeur·se·s.
Signons ici la lettre de soutien collective pour appuyer la demande de résidence pour considérations d’ordre humanitaire de la famille Nkunga Mbala.
Que se passe-t-il si la demande pour motifs d'ordre humanitaire est refusée ?
La demande humanitaire est le dernier recours légal à la disposition des demandeur·se·s d’asile pour obtenir la résidence permanente. En moyenne, 70 % des demandes sont rejetées. En cas d’émission d’un avis d’expulsion, les demandeurs d’asile peuvent présenter une demande d’examen des risques avant renvois (ERAR). Il s’agit de l’ultime étape administrative pour éviter d’être renvoyé·e dans son pays d’origine ou un pays où on a la nationalité. L’ERAR est une réévaluation des risques encourus si la personne est envoyée dans son pays.
On estime qu’environ 6 % des demandeur·se·s d’asile refusé·e·s sont renvoyé·e·s du Canada après avoir épuisé tous les recours juridiques décrits ici. D’autres finissent par rester sans statut pendant des années au Canada, en se cachant des autorités. De l’arrivée au Canada jusqu’à l’obtention d’un statut (ou dans le pire des cas, jusqu’à la déportation), la précarité est au cœur de l’expérience des demandeur·se·s d’asile. La crainte d’être renvoyé·e, la barrière de la langue et des codes culturels, la difficulté à obtenir de l’aide juridique, les limitations dans l’accès à l’emploi et à certaines prestations sociales, l’impossibilité de voyager (vu l’impossibilité de revenir au Canada si on quitte le territoire) et l’incapacité à se projeter dans l’avenir font de l’instabilité générale un motif de fond dans la vie des demandeur·se·s d’asile.
Comme le dit Peggy : « J’ai l’impression de vivre ma vie en suspens. »
Dès aujourd’hui, agissons pour accueillir dignement les demandeurs d’asile au Canada.
SOURCES
[3]Statistiques sur les réfugiés (2023). HCR Canada.
[4]Aperçu statistique (s.d.). HCR – The UN Refugee Agency.
[5]Information de base sur les réfugiés (s.d.). Canadian Council for Refugees
[6]Convention et Protocole relatifs au Statut des Réfugiés(s.d.). HCR – The UN Refugee Agency.
[7]Schué, R. (2023, January 21). Près de 100 000 demandeurs d’asile au Canada l’an passé. Radio Canada.
[9]Convention et Protocole relatifs au Statut des Réfugiés(s.d.). HCR – The UN Refugee Agency.
[11]Services en ligne – Aide financière de dernier recours. (n.d.). Gouvernement Du Québec.
[12]Convention et Protocole relatifs au Statut des Réfugiés(s.d.). HCR – The UN Refugee Agency.